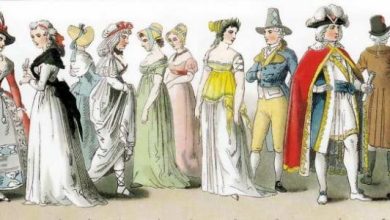Les matières organiques dans l’eau : Définition, Sources et Impacts environnementaux
L’eau, composant essentiel de la biosphère, est bien plus qu’un simple solvant. Elle transporte une multitude de substances dissoutes, dont une partie provient de matières organiques. Ces matières, qui sont des composés de carbone, jouent un rôle crucial dans les écosystèmes aquatiques, mais peuvent aussi avoir des impacts significatifs sur la qualité de l’eau, la santé humaine et l’environnement. Dans cet article, nous explorerons la définition des matières organiques dans l’eau, leurs sources, leurs types, ainsi que leurs effets et leur gestion dans les milieux aquatiques.
1. Qu’est-ce que les matières organiques dans l’eau ?
Les matières organiques dissoutes dans l’eau comprennent une large gamme de composés qui contiennent du carbone. Ces composés sont principalement issus de la dégradation de la matière organique vivante ou morte, comme les plantes, les animaux et les micro-organismes. En termes simples, il s’agit de toutes les substances d’origine biologique qui se retrouvent dans les systèmes aquatiques.
Les matières organiques se divisent généralement en deux grandes catégories :
- Les matières organiques dissoutes (MOD) : Ce sont des molécules organiques solubles dans l’eau. Elles comprennent des substances comme les acides humiques et fulviques, qui proviennent de la dégradation de la matière organique végétale, ainsi que des substances organiques plus petites produites par des micro-organismes.
- Les matières organiques particulaires (MOP) : Ce sont des particules de matière organique qui ne se dissolvent pas dans l’eau mais qui y sont suspendues. Elles comprennent des restes de débris végétaux et animaux, ainsi que des cellules de micro-organismes.
Ces matières organiques jouent un rôle important dans le cycle biogéochimique de l’eau, en influençant les propriétés chimiques, biologiques et physiques de l’eau.
2. Sources des matières organiques dans l’eau
Les matières organiques dans l’eau proviennent de différentes sources naturelles et anthropiques (celles dues aux activités humaines). Parmi les sources principales, on peut citer :
- Les sources naturelles :
- La dégradation des végétaux et animaux : Les feuilles mortes, les branches, les racines et autres débris organiques issus des plantes et des animaux se décomposent dans les milieux aquatiques, libérant ainsi des matières organiques.
- Les matières organiques d’origine terrestre : Les forêts, les prairies et les terres agricoles sont des zones sources de matières organiques qui peuvent être transportées par ruissellement ou infiltration dans les cours d’eau. Ce processus est particulièrement visible dans les zones humides.
- Les matières organiques des micro-organismes : Les bactéries, champignons et autres micro-organismes présents dans l’eau jouent un rôle majeur dans la dégradation de la matière organique et la libération de nouvelles formes de composés organiques dans le milieu.
- Les sources anthropiques :
- Les activités agricoles : L’utilisation d’engrais organiques et de pesticides dans les pratiques agricoles peut entraîner la lixiviation de matières organiques dans les nappes phréatiques et les rivières. Les résidus organiques provenant des sols peuvent également être transportés par les pluies dans les rivières et les lacs.
- Les effluents domestiques et industriels : Les eaux usées des foyers, des industries et des collectivités, riches en matières organiques provenant des résidus alimentaires, des huiles, des savons et d’autres produits chimiques, sont souvent déversées dans les cours d’eau sans traitement adéquat. Cela entraîne une augmentation des matières organiques dissoutes et particulaires.
- Les rejets de stations d’épuration : Bien que les stations d’épuration soient conçues pour éliminer une grande partie des polluants organiques, des quantités importantes de matières organiques restent présentes dans les effluents, qui peuvent avoir un impact sur la qualité de l’eau réceptrice.
3. Types de matières organiques dans l’eau
Les matières organiques dans l’eau se distinguent selon leur origine, leur taille et leur composition chimique. Elles peuvent être classées en plusieurs catégories spécifiques :
- Les acides humiques et fulviques : Ce sont des substances organiques complexes, riches en carbone, qui se forment lors de la dégradation de la matière organique végétale. Ces composés sont principalement responsables de la couleur brunâtre des eaux humides et sont souvent associés à la turbidité et à l’absorption des rayonnements ultraviolets.
- Les glucides et protéines dissoutes : Ces substances organiques proviennent de la dégradation des micro-organismes ou de la matière végétale. Les glucides dissous (comme les sucres simples) et les protéines constituent une part importante des matières organiques dissoutes, particulièrement dans les milieux riches en nutriments.
- Les lipides : Ce sont des molécules organiques hydrophobes, comme les graisses et les huiles, qui proviennent généralement de la dégradation des matières animales ou de certains végétaux. Les lipides peuvent rendre l’eau moins transparente et peuvent avoir des effets néfastes sur la faune aquatique.
- Les substances organiques solubles : Les substances solubles dans l’eau peuvent être issues de la dégradation de la matière organique, ou résultent de l’activité biologique des plantes et animaux aquatiques. Elles peuvent inclure des acides organiques, des aldéhydes et des ketones.
4. Impacts des matières organiques sur l’environnement et la qualité de l’eau
Les matières organiques jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes aquatiques, mais elles peuvent également entraîner divers problèmes environnementaux. Leur présence en excès peut avoir des effets négatifs notables sur la qualité de l’eau.
- La demande biochimique en oxygène (DBO) : Les matières organiques dissoutes et particulaires sont dégradées par les micro-organismes présents dans l’eau. Ce processus consomme de l’oxygène dissous, un facteur crucial pour les organismes aquatiques tels que les poissons et les invertébrés. Une augmentation excessive de la DBO peut entraîner une hypoxie (manque d’oxygène) dans les écosystèmes aquatiques, menaçant la faune et la flore.
- L’eutrophisation : Lorsqu’il y a une surabondance de matières organiques, en particulier de nutriments comme l’azote et le phosphore, cela peut favoriser la croissance excessive des algues dans les lacs, les rivières et les étangs. Cette prolifération d’algues, appelée « bloom algal », peut bloquer la lumière, perturber l’équilibre de l’écosystème aquatique et entraîner une diminution de la biodiversité.
- La turbidité et la couleur de l’eau : Les matières organiques particulaires, telles que les débris végétaux et les micro-organismes, augmentent la turbidité de l’eau, ce qui réduit la transparence et peut affecter la photosynthèse des plantes aquatiques. De plus, certaines matières organiques comme les acides humiques peuvent colorer l’eau, la rendant brune et moins attrayante.
- Les impacts sur la santé humaine : Les matières organiques, notamment les résidus de produits chimiques industriels ou agricoles, peuvent contaminer l’eau potable et présenter des risques pour la santé publique. Par exemple, les résidus d’herbicides et de pesticides dans l’eau peuvent provoquer des maladies chroniques et des perturbations hormonales chez l’homme et les animaux.
5. Gestion des matières organiques dans l’eau
La gestion des matières organiques dans les eaux nécessite une approche intégrée, combinant la réduction des sources de pollution et le traitement efficace des eaux usées. Parmi les solutions possibles, on trouve :
- Le traitement des eaux usées : Les stations d’épuration modernes utilisent des procédés biologiques (comme les boues activées) pour éliminer les matières organiques dissoutes et particulaires des eaux usées avant leur rejet dans les milieux récepteurs.
- La gestion durable de l’agriculture : Des pratiques agricoles telles que l’utilisation réduite de produits chimiques et l’adoption de techniques de conservation des sols peuvent aider à minimiser la lixiviation des matières organiques dans les eaux de surface et les nappes phréatiques.
- La restauration des écosystèmes aquatiques : La régénération des zones humides et des rives des rivières peut aider à filtrer les matières organiques et à protéger la qualité de l’eau.
Conclusion
Les matières organiques dans l’eau, bien qu’elles jouent un rôle fondamental dans les cycles naturels et la vie aquatique, peuvent avoir des effets délétères sur les écosystèmes et la santé humaine lorsqu’elles sont présentes en excès. Une gestion efficace de ces matières, tant au niveau des sources que du traitement, est essentielle pour maintenir la qualité de l’eau et préserver la biodiversité aquatique.